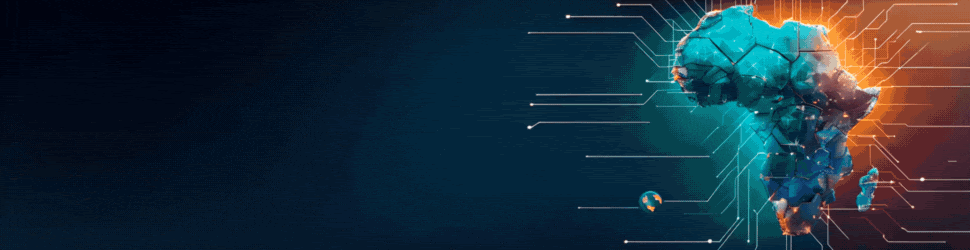Le dialogue sur la libéralisation des visas entre l’UE et la Turquie a été remplacé par des discussions sur la « facilitation des visas ». Les citoyens turcs ont des difficultés à obtenir des visas Schengen. Pourquoi le dialogue sur les visas entre la Turquie et l’UE est-il au point mort ? Pourquoi y a-t-il un problème de visas Schengen ?
Les négociations entre la Turquie et l’Union européenne (UE), entamées en 2013 pour lever l’obligation d’obtenir un visa Schengen pour les citoyens turcs, sont dans l’impasse pour des raisons techniques et politiques. Lancé le 16 décembre 2013, en même temps que l’accord de réadmission Turquie-UE, le blocage du dialogue sur la libéralisation des visas découle de problèmes ou d’équilibres politiques internes à la Turquie et à l’UE.
Selon un rapport de DW Turkish, la feuille de route préparée pour la Turquie en vue de la libéralisation des visas comprend 72 critères. Ces critères sont classés en cinq groupes thématiques : Sécurité des documents, gestion des migrations, ordre public et sécurité, droits fondamentaux et réadmission des migrants en situation irrégulière. La Commission européenne a confirmé que la Turquie remplissait 66 de ces 72 critères.
Cependant, les six critères restants nécessitent une volonté politique et une décision au plus haut niveau. Ces critères sont énumérés comme suit : « révision de la loi antiterroriste, mise en œuvre des recommandations du Conseil de l’Europe et du GRECO (Groupe d’États contre la corruption), adaptation de la loi et de l’institution sur la protection des données personnelles aux normes de l’UE, garantie de la coopération judiciaire avec tous les États membres de l’UE et signature d’un accord de coopération opérationnelle avec EUROPOL ».
Décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et du GRECO
La révision de la loi antiterroriste et les recommandations du GRECO sont également importantes dans le cadre du dialogue et de la coopération avec le Conseil de l’Europe, dont la Turquie est membre. Ankara est obligée de prendre des mesures dans ces domaines même s’il n’y a pas de dialogue sur les visas avec l’UE.
Il n’y a pas de critère de référence de l’UE concernant la loi antiterroriste. L’UE souhaite une nouvelle législation dans ce domaine qui soit conforme à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). L’UE, tout comme le Conseil de l’Europe, dont la Turquie est membre, estime que la définition actuelle du terrorisme en Turquie est « interprétée de manière trop large » sur la base des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires telles qu’Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, le dossier ByLock ou d’autres affaires similaires jouent donc un rôle essentiel.
La Turquie et l’UE prendront-elles des mesures pour les visas ?
Le GRECO, quant à lui, émet des recommandations basées sur des » processus d’évaluation » qui mesurent la conformité des États membres avec les normes anticorruption établies par le Conseil de l’Europe. Depuis 2017, la Turquie participe à la cinquième phase d’évaluation du GRECO. Cette phase porte sur « la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité au sein du gouvernement central et des autorités chargées de l’application de la loi ». Le processus d’évaluation précédent portait sur les questions de lutte contre la corruption pour les membres du parlement, les juges et les procureurs.
La coopération judiciaire avec tous les pays de l’UE est problématique dans la mesure où elle inclut la République de Chypre, un État membre de l’UE qu’Ankara ne reconnaît pas. En d’autres termes, même si la Turquie remplit tous les autres critères, tant qu’elle ne reconnaît pas officiellement la République de Chypre, elle se heurtera au moins au veto du duo gréco-grec.
La dynamique intra-UE est négative
Bien que des sources européennes, en particulier la Commission européenne, aient indiqué que la libéralisation des visas était possible une fois ces critères remplis, la dynamique actuelle au sein de l’UE indique que la libéralisation des visas pour les citoyens turcs ne sera pas facile.
Une fois que la Turquie aura rempli les six critères restants et que la Commission européenne aura publié un rapport positif, le Parlement européen (PE) et tous les États membres devront approuver la libéralisation des visas. Le Parlement européen a adopté des résolutions qui lient les progrès réalisés dans la modernisation de l’union douanière et le dialogue sur les visas avec la Turquie aux progrès réalisés dans les domaines de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit.
Cela inclut la reconnaissance de la République de Chypre par Ankara. Les élections pour la législature 2024-2029 se tiendront le 9 juin et devraient déboucher sur une majorité de droite plus extrême ou radicale au Parlement européen. Un tel scénario fermerait encore davantage la porte à la Turquie au sein de l’UE.
La montée des partis populistes d’extrême droite et anti-UE dans l’ensemble de l’UE est un autre facteur qui empêche les partis traditionnels de mettre le dossier de la Turquie, en particulier la libéralisation des visas pour les citoyens turcs, à l’ordre du jour en Europe. C’est particulièrement le cas dans les pays d’Europe occidentale tels que l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche et le Danemark. Dans ces pays, la libéralisation des visas pour les citoyens turcs est un « produit politique non commercialisable ».
Si l’on ajoute à cela les débats houleux en Europe sur la question des réfugiés, le fait que le plus grand nombre de demandeurs d’asile dans l’UE au cours des dernières années ont été des détenteurs de passeports turcs, et le scepticisme à l’égard des musulmans dans toute l’Europe, on peut dire sans risque de se tromper que la libéralisation des visas a peu de chances de se concrétiser à court ou à moyen terme.
Facilitation des visas plutôt que libéralisation des visas
C’est pourquoi le « dialogue sur la libéralisation des visas » entre l’UE et la Turquie cède peu à peu la place à des discussions sur la « facilitation des visas ». Ankara, qui ne peut envisager une libéralisation des visas pour tous ses citoyens à court ou moyen terme, fait désormais pression en faveur d’une libéralisation ou d’une facilitation des visas pour des groupes spécifiques tels que les hommes d’affaires, les étudiants, les artistes, les universitaires ou les journalistes. Il est question de délivrer des visas Schengen plus rapides et, si possible, plus longs à ces groupes. Pour les touristes qui se rendent dans les pays de l’espace Schengen, l’UE fait pression pour accélérer la procédure de délivrance des visas, qui a récemment été extraordinairement lente.
Le ministre des affaires étrangères, Hakan Fidan, qui a reçu le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Oliver Varhelyi, à Ankara la semaine dernière, a déclaré à l’issue de la réunion : « Nous nous entretenons individuellement avec les pays de l’UE et nous discutons de cette question avec les institutions européennes afin de faciliter la délivrance des visas, en particulier pour les hommes d’affaires et les étudiants ».
Il ne suffira pas de mener ces négociations au niveau technique avec l’actuelle Commission européenne, qui cessera d’exister dans les mois à venir. Les négociations doivent être menées directement avec les États d’Europe occidentale, en particulier Berlin et Paris. En effet, la libéralisation ou la facilitation des visas est sciemment instrumentalisée par certains pays de l’UE pour obtenir des concessions de la part d’Ankara, en particulier dans le domaine de la politique étrangère. Ankara doit négocier avec les gouvernements d’Europe occidentale tout en se réformant pour surmonter cet obstacle.
La Turquie a créé une Europe sans visa
Le dialogue sur les visas entre la Turquie et l’Europe après la Seconde Guerre mondiale a toujours été entravé par des troubles politiques internes. Cependant, la Turquie a été l’un des 13 pays d’Europe occidentale qui ont jeté les bases du concept d' »Europe sans visa » au sein du Conseil de l’Europe, dont elle est devenue membre en 1949. Ainsi, jusqu’en octobre 1980, les citoyens turcs pouvaient se rendre dans les États membres du Conseil de l’Europe sans visa.
La procédure de visa pour les citoyens turcs a commencé le 9 juillet 1980, juste avant le coup d’État militaire du 12 septembre, lorsque la République fédérale d’Allemagne a annoncé qu’elle suspendait unilatéralement un accord sur l’exemption de visa pour les citoyens turcs qui avait été signé et ratifié au sein du Conseil de l’Europe dans les années 1950. Immédiatement après le coup d’État du 12 septembre, tous les pays d’Europe occidentale ont suivi l’exemple de l’Allemagne.
S’exprimant lors d’une session plénière de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg en 1985, Hans-Dietrich Genscher, ministre fédéral des affaires étrangères de l’Allemagne, a déclaré à propos du régime des visas : « Depuis le 5 octobre 1980, nous sommes en train de mettre en place un régime d’exemption de visa pour les citoyens turcs : « Depuis le 5 octobre 1980, nous avons introduit des visas pour les citoyens turcs. De plus, cela n’a pas été fait unilatéralement, mais en collaboration avec le gouvernement turc qui était au pouvoir avant que les généraux ne prennent le contrôle de la Turquie. Nous l’avons fait parce que le nombre de ressortissants turcs entrant dans notre pays dépassait notre capacité à les absorber. Je suis convaincu que le régime des visas sera maintenu pendant longtemps jusqu’à ce que les conditions de vie en Turquie atteignent le niveau de la Communauté européenne et du Conseil de l’Europe et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de raisons pour que les gens quittent leur pays en raison des conditions de vie.